|
Publications
|
Les Avatars de l'amour
|
|
|
Un
avatar, c'est une métamorphose, une transformation, entre deux
formes de la vie. Et chacun sait que l'amour, qui rapproche
sexuellement et met aux prises deux êtres, connaît des
avatars, des métamorphoses surprenantes, dont la principale,
bien connue des thérapeutes, c'est le symptôme.
Car un symptôme est une sorte de "mot" d'amour
malheureux, un mot souvent assez gros, qui peut être très
compliqué. La plupart des symptômes contiennent - et
retiennent - un élan d'amour bloqué, arrêté, ou enlisé. La
plupart des symptômes dont parlent et souffrent nos patients,
sont une manière de faire avec l'amour qui empêche de le faire
exister ou de le faire, tout simplement. Il se peut même que
tout symptôme questionne, outre la possibilité de vivre, celle
d'aimer et d'œuvrer. Il arrive que certains constatent, à un
âge conséquent, qu'ils n'ont pas eu une "vraie"
histoire d'amour; mais ils se doutent que s'ils l'ont contournée,
s'ils ont évité de s'y exposer, c'est que la moindre atteinte
aurait été fatale pour eux, ou destructrice, dans l'état de
mise à nu où ils auraient pu se trouver tant il est vrai que
le symptôme qui les couvre est resté implacable. C'est là un
cas banal, mais un cas encore plus banal est celui où l'on
parle de l'amour qui s'éteint par une sorte de fatigue, de
routine, d'usure du désir. Je pense, avec l'approche que je
vous propose pour le symptôme, que s'il y a effet d'usure ou de
fatigue, ce n'est pas dû à la répétition de l'amour: ce qui
se répète et qui épuise, c'est de buter de la même façon
sur le symptôme de l'autre, sachant que celui qu'on a ne s'y
ajuste pas vraiment. Bien sûr on peut aller jusqu'à aimer
l'autre au-delà de son symptôme; l'amour narcissique peut
aller jusqu'à absorber l'autre, symptôme compris. On troque
alors l'usure contre la dévoration. On peut aussi, bien sûr,
faire sa place au symptôme de l'autre en l'interprétant, en le
posant comme événement indépassable d'une histoire plus
lointaine, donc en basculant dans un amour englobant où le désir
laisse quelques plumes. En règle plus générale, on bute sur
le symptôme de l'autre en tant que c'est la façon qu'a l'autre
de "fixer" son rapport à l'amour. Et quand ça bute régulièrement
et que l'amour finit par s'user, c'est comme si l'un des
partenaires découvrait que l'autre aimait un tiers plus que
lui, plus que le lien qui lie le couple, et ce tiers c'est le
symptôme. Cette idée n'est qu'à moitié
"pessimiste", car elle montre que même sous la forme
de symptômes, l'amour et le désir ont quelque chose
d'increvable, et qu'il "suffit", pour les vivre, de
les déloger quelque peu de l'impasse où les a mis une économie
pulsionnelle un peu "juste". Et il faut bien les libérer
car ce qu'on attend de l'amour - une régénération de soi -
nul symptôme ne le fournit. Du reste, il arrive souvent qu'on
aime l'autre non pas pour ce qu'il est, ou ce que nous sommes,
mais parce qu'il est l'occasion de revivre l'état de l'énamoration
où justement l'amour semble à nouveau libéré et s'offrir à
être encore revécu. Dans ces cas, on aime l'autre par
"reconnaissance" - sous le signe de l'amour qui dépasse
l'un et l'autre.
|
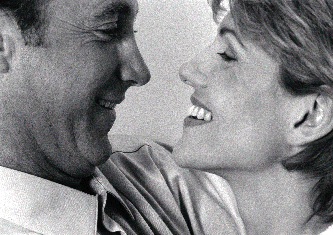
|
|
|
Qu'est-ce qu'on attend de l'amour? On est très loin de ce que
Platon dit là-dessus: pour lui on attend de l'aimé qu'il nous
complète. Je dirai presque le contraire: on attend de l'aimé
qu'il nous décomplète: qu'il nous donne notre manque-à-être
sous une forme vivante. On l'aime, non parce qu'il obture notre
manque et l'apaise, mais parce qu'il nous le révèle comme un
appel de vie, comme vivant et vivable. On l'aime parce qu'il
nous donne - nous redonne - la faille fondatrice, ontologique,
entre l'être et ce-qu'on est, la faille qui ouvre le
narcissisme, celle qui fait communiquer notre présence au monde
avec l'être qui la porte et la traverse, avec "autre
chose" qui n'est pas toujours "le divin", ou pas
encore, mais qui est déjà l'au-delà de ce que nous sommes
avec nos cadres, nos limites, nos contours narcissiques inscrits
ou fantasmés. C'est vrai pour le couple de passage (si le
passage est consistant) et pour le couple engagé, installé,
"marié". Soit dit en passant le mariage se rompt
parce qu'il est devenu facile à rompre, mais son enjeu reste précis:
aller chercher, grâce au lien qu'il inscrit, un supplément de
symbolique, c’est-à-dire d'une certaine transmission de
l'amour. Outre que ceux qui se séparent basculent rarement dans
la vie monacale, (en somme ils refont couple ou se remarient
d'une façon ou d'une autre), il est possible qu'après un
certain épuisement, du mariage (sous l'entrechoc des symptômes)
et du divorce (sous l'effet du symptôme dépressif) il est
possible que l'on assiste à un regain: le désir de lien et
l'amour du symbolique peuvent à nouveau se présenter, sous le
signe de la promesse - qui est plus faite pour être vécu que
"tenue".
Mais pour revenir à ce qu'on attend de l'amour, quand l'écran
des symptômes cesse d'être étanche, on peut être plus précis.
Dans la rencontre de l'amour, qui n'est pas le rendez-vous mais
l'ensemble de ce qui va se donner lieu, les deux partenaires
viennent chacun avec sa coupure entre corps-visible et corps-mémoire,
ou corps charnel et corps inconscient; chacun est un
entre-deux-corps. Imaginons qu'il y ait rencontre, et qu'elle
soit au-delà de la séduction (la séduction est
incontournable, mais si on y reste, ce n'est plus de l'amour,
c'en est une fétichisation; de même pour la séduction
charnelle, qui existe, qui est même assez fréquente: des gens
font l'amour dans l'espoir de le faire apparaître). On a quatre
termes, quatre instances, chacune étant un entre-deux. La
rencontre produit un effet de croisement singulier: votre
corps-charnel répond au corps-mémoire de l'autre, et votre
corps-mémoire à son corps-charnel. Tous les grands textes en témoignent,
et l'expérience aussi: la chair vibre appelée par des mots ou
des signes abstraits, et la pensée s'émeut à l'appel de la
chair de l'autre. Ce croisement, qui est le propre de l'amour,
et dont le rapport sexuel semble être la quintessence, se
produit quel que soit le temps, l'époque, depuis les temps pré-bibliques
ou médiévaux jusqu'à la post-modernité. Les deux
"entre-deux" tentent de s'ajuster, de s'accorder, avec
le risque bien sûr que ce soit les symptômes qui s'ajustent
trop bien. Ce qui est sûr, c'est que chacun, recevant du choc
avec l'autre son manque-à-être, son ouverture à l'être, il
se forme un triangle: dans le cas de la rencontre homme-femme
(c'est quand même ce couple qui a transmis l'humanité, et on
peut donc sans abuser lui donner la priorité, la souveraineté),
il se forme un triangle où les deux termes, les deux pôles se
complètent d'un troisième que j'appellerai, pour aller vite,
l'être. Ainsi les deux amours de l'un et l'autre s'accrochent
à un troisième terme qu'on peut appeler amour de l'être.
C'est lui qui permet de "passer" (par-dessus) les
symptômes. Et sans cet amour de l'être, c'est la prédation
des jouissances où la plus tenace l'emporte.
Ce passage par autre chose, que j'appelle l'être, et qui est au
minimum l'univers des possibles, semble essentiel dans l'amour.
Lui seul peut expliquer que certains couples perdurent dans le
mariage, avec un amour indéniable, sans que les rapports
sexuels soient fréquents ou marquants; et pourtant, sans aucune
résignation (seul le témoin extérieur la voit par ce qu'il la
projette sur eux), ils se construisent quelque chose sous le
signe de l'amour de l'être, sachant qu'à tout moment le
croisement est possible entre corps-mémoire et corps-visible,
de l'un et l'autre.
Cet accrochage ou ce croisement qui fondent aussi ce qu'on nomme
le coup de foudre, on le trouve déjà dans certains couples
bibliques qui furent évoqués ici. Relisez la rencontre d'Isaac
et de Rebecca, c'est un coup de foudre par transfert ou
transport: le père d'Isaac envoie son serviteur prendre femme
pour son fils dans le pays de ses origines. (L'amour de l'être
c'est aussi cela : compter avec les origines, pour ressaisir de
façon vivable la perte d'origine, la perte originelle. Un des
avatars de l'amour c'est le deuil, plus ou moins réussi, de
cette perte.) Et le serviteur arrive au pays et organise une scène
à la Breton: me voilà à la source où les jeunes filles
viennent puiser l'eau, et celle qui répondra à ma demande:
"Oui, je te donnerai à boire et à tes chameaux aussi je
donnerai à boire", je saurai que c'est celle-là que tu as
destiné à ton serviteur. (Il parle à l'être divin.) Et il
attend, et les choses se passent comme il l'a espéré. On
dirait Breton au café, qui se dit: Si la femme à l'autre table
se lève quand j'ai fini ma lettre d'amour, alors c'est à elle
que je l'écrivais… Agencement humoristique de l'étincelle,
du coup de foudre, mais dans la Bible c'était par procuration.
Entre nous, si elle doit penser faire boire les chameaux, c'est
qu'elle doit déjà les avoir remarqués, comme véhicule
essentiel pour partir ailleurs, pour franchir le désert. C'est
donc qu'elle est prête à l'aventure. Et quand elle arrive vers
Isaac, c'est le coup de foudre, et le Texte mentionne: Isaac la
mena dans la tente de sa mère et il s'est consolé avec elle de
la mort de sa mère. Voilà, c'était parti sur le mode
incestuel avec la mère et ça se poursuit avec la femme sur un
mode consolant, de retour à la vie.
Le croisement dont je parle dépasse la question de la symétrie
entre les sexes. Du reste c'est ainsi que j'interprète la scène
où Eve sort d'un os d'Adam: façon de rééquilibrer le fait évident
que l'homme sort du ventre de la femme. Façon de rétablir non
pas une symétrie mais un certaine équilibrage. La symétrie
c'est l'équilibrage des pauvres… d'esprit. Il faut que ce
soit pareil de chaque côté. Or ce qui donne le mouvement et l'émotion
c'est non seulement la différence irréductible mais le jeu des
entre-deux, leurs croisements variés; la capacité des deux à
transiter par le tiers que j'appelle l'amour de l'être.
Certes, le fait que ça ne tombe pas juste, sauf ajustage des
symptômes, est une source de gémissements et de sagas tristes,
scandées par ce refrain: les histoires d'amour se terminent
toujours très mal. Avec notre approche, on le comprend très
bien : la rencontre commence, le croisement s'amorce, se
poursuit, mais un moment ou l'autre, chacun envoie sa petite fusée
chercheuse qui continue à poursuivre sa jouissance
symptomatique. Et lorsqu'elle atteint sa cible, le symptôme du
sujet, alors celui-ci entre en compulsion; autant dire qu'il
entre en religion, et l'autre ne peut pas l'en faire sortir. Ils
peuvent toujours satisfaire la pulsion de temps à autre, mais
ce qui l'emporte c'est la compulsion qui finit par casser
l'amour.
Les pièces de Shakespeare sur l'amour - car il n'y a pas que la
Bible et les romans - se terminent souvent très mal. Voyez
celle où Cléopâtre annonce dès le début la couleur : je
veux savoir jusqu'où je peux être aimée… C'est un programme
compulsif increvable, car toute limite une fois atteinte doit être
repoussée, toute réponse obtenue doit être récusée. Mais
dans le trajet, la femme bute sur ce paradoxe, si courant :
l'homme doit être son instrument, mais il doit être, en même
temps, un homme, c’est-à-dire différent d'elle et qui échappe
à ses programmes. Elle doit le façonner mais il doit y résister.
C'est presque un double-bind.
Certes, cela questionne le devenir homme, mais la femme aussi
bute violemment sur la question du devenir femme. J'ai appelé
ce voyage ou ce problème: l'entre-deux-femmes. J'ai introduit
cette notion (en 1978), dans La haine du désir, en vue de
reformuler le problème de l'hystérie qui me semblait mal posé:
le problème d'une femme, ce n'est pas l'homme ou le pénis,
c'est l'autre-femme en tant que supposée détenir les attributs
du féminin et à qui il faut les prendre, les arracher,
puisqu'elle (ou la mère) refuse de les transmettre. Les lui
prendre, avec l'angoisse d'échouer ou la culpabilité de réussir.
Cela ne veut pas dire que l'envie du pénis soit négligeable,
mais elle prend dans notre approche une autre forme. Dans le
rapport sexuel homme-femme, chacun des deux a un sexe
biologique; il y a le sexe de la femme avec toute sa complexité,
le sexe de l'homme, le pénis, qui n'est pas vraiment simple;
mais en plus de ces deux, il y a un objet supplémentaire qui
fait le joint. Il se trouve que c'est l'homme qui le porte, le
long de son pénis. Il fallait bien que l'un des deux porte
l'emblème de ce passage par le tiers. L'homme le porte, vu que
la femme a d'autres choses à porter… Dans l'érection,
essentielle au rapport sexuel, le désir de l'un ou l'autre,
mais plutôt des deux, allume le joint; et ce joint appartient
aux deux. L'homme le porte dans le rapport, mais après le
rapport, il en est plutôt encombré. Bien souvent on confond
son pénis avec sa capacité de jointure, qui est celle des deux
(car si la femme n'en veut pas, le joint ne veut pas s'allumer,
ou il s'éteint à tout bout de champ); de même si elle le veut
trop, par rapport au vœu de l'homme. Si les symptômes butent
l'un sur l'autre, le joint a du mal à s'allumer. Plus tard,
l'un des avatars de ce joint ce sera l'enfant: c'est souvent lui
qui fait le joint entre les deux, à ses risques et périls.
|
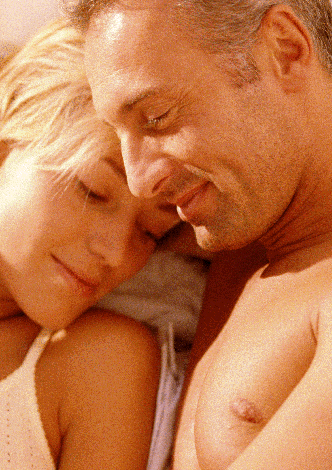 |
|
| |
Daniel Sibony
|
|

|